Actions
Articles | Ressources Documentaires
1944 – 1984 : 40 ans de transport maritime
Son départ à la retraite n’a pas éteint cette passion qu’il a eue de comprendre et de faire comprendre les problèmes qui se sont posés aux navigants, qu’ils soient de la pêche ou du commerce. A 76 ans, il reste un témoin précieux.
Jean SAUVEE – fondateur du « MARIN »
Ce sont les circonstances qui ont fait de ce marin un homme de plume. Au début des années 30, alors jeune lieutenant au Long cours, il se trouve confronté comme tant d’autres à la pénurie d’embarquements. La situation de la flotte de commerce est aussi dégradée sinon plus qu’elle ne l’est aujourd’hui. Les périodes de « mise à sec » se faisant trop nombreuses, il finit par répondre positivement aux sollicitations du rédacteur en chef d’ « Ouest-Eclair », Anastase Moreux. A charge pour lui de s’occuper du maritime. Ce qu’il fera à partir de Lorient, ville dont il est originaire et où il donnera parallèlement des cours à l’école de navigation.
Pendant les années d’occupation, l’enseigne de vaisseau de première classe sauvée occupera le poste de chef de service de presse de la rue Royale, à Paris, c’est-à-dire de l’Amirauté. L’Amirauté exercera son autorité sur toutes les activités maritimes jusqu’à la Libération. Au risque de déplaire, Jean sauvée est de ceux qui pensent que le gouvernement de Vichy a eu en matière de marine marchande une politique constructive. Au sortir des hostilités, on fera appel à lui pour lancer le « marin ». Il occupera par la suite le poste de chef de rédaction parisienne du quotidien « Ouest-France », et c’est là que jean sauvée traitera sans relâche l’actualité maritime.
Vouant une grande admiration pour l’œuvre de Colbert, Jean Sauvée reste aujourd’hui un ardent défenseur du régime spécifique des marins. Il n’est peu dire que les difficultés auxquelles se trouve confrontée la flotte de commerce française l’attriste. Pour éviter le déclin, il aurait fallu, selon lui, que se dessine une grande volonté politique. Ce qui, pense-t-il, n’a jamais été le cas.
40 ans, c’est une belle page d’histoire.
Si nous devions la réécrire, quels en seraient les grands chapitres ?

1944 ne me semble pas une année significative, sur le plan de la marine du commerce, si ce n’est que la flotte marchande française est exsangue. Plus des deux tiers des navires ont disparu ou ne sont plus en état de naviguer. Il faudra attendre 1946, pour que s’engage le processus de reconstruction. E, 1953, on peut dire que la flotte française est remise sur pied, pas en nombre de navires mais en nombre de tonnage. A noter, une modification par rapport à la période d’avant-guerre : la part des navires à passagers n’est plus aussi grande. Les pétroliers sont désormais plus nombreux. Ils seront, de longues années durant, la locomotive de la marine marchande.
A partir de 1953, on entre dans une seconde période, celle de la perte de notre fonds de commerce. Avant la guerre, ce fonds de commerce maritime était basé, essentiellement, sur les colonies. 135 navires travaillaient, presque exclusivement sur le trafic méditerranéen, en 1953. La France était, bien entendu, présente sur l’Atlantique Nord. C’est là que se jouait, par paquebots interposés, le prestige des nations maritimes. Mais pour le frêt, la marine marchande œuvrait en Afrique et en Extrême- Orient. Nos colonies ayant accéder à l’indépendance, notre fonds de commerce s’en est trouvé affaibli. Il s’en suivra une difficile reconversion, d’autant plus difficile qu’elle n’a pas été préparée.
En 1963, apparaissent les premiers navires « automatisés ». Et dès lors, s’engage le processus de réduction des effectifs. Accentué par un autre mouvement, le gigantisme des navires. Et pas uniquement pour les pétroliers.
Revenons 40 ans en arrière.
La France n’est pas encore libérée, mais pour beaucoup, cela ne saurait plus tarder.
Se trouve-t-il des gens pour se préoccuper de l’avenir de la marine marchande

La flotte d’après-guerre a été préparée, presque secrètement, par le secrétariat de la marine marchande, qui était alors placé sous l’autorité de l’Amirauté. Il me faut, ici, rendre hommage à un homme, l’ingénieur général Coureau. C’est lui qui a préparé et réalisé, en partie, cette reconstitution. Pendant l’occupation et après, puisqu’en 1948, il devenait secrétaire général de la marine marchande. Les plans qui avaient été échafaudés, pendant la guerre, ont été revus et corrigés, en fonction de ce que l’on a retrouvé. Au 8 mai 1945, on ne savait pas exactement quels étaient les navires que nous pourrions récupérer. On ne parlait pas encore des « Liberty ships ». il est bien évident, que l’entrée en flotte des « liberty ships », des « Empires » et autres « T2 » a modifié considérablement les perspectives. Il convient de préciser, que dans le programme du Conseil national de la résistance, il était prévu la nationalisation de la flotte de commerce
Les armateurs, qui ont subi des pertes, pendant les six années de guerre, ont-ils retrouvé leurs billes ?
On peut affirmer que les armateurs français ont été gagnants. En septembre 1940, ils n’étaient plus libres d’agir à leur guise. La flotte de commerce était réquisitionnée. Une charte partie liait les armements à la direction des Transports maritimes placée sous l’autorité de l’Amirauté. Les armateurs n’avaient plus qu’un rôle à jouer, celui d’agent technique. L’exploitation des navires était assurée par la direction des Transports maritimes. Par cette charte partie, l’Etat s’était engagé à rendre ces navires dans le même état ou à les remplacer. Il faut bien reconnaître, qu’en 1939, malgré un apport d’un très grand nombre de pétroliers, il y avait peu de navires récents et de bonne qualité sous pavillon français.
Les armateurs moyennant le paiement d’une soulte d’âge, relative à l’ancienneté de leurs navires disparus, ont donc touché des navires neufs construits à leur convenance.
Est-ce qu’au sortir de la guerre, on sent se dessiner une volonté politique de jouer à fond la carte du transport maritime ?
Malheureusement pas ! Le premier plan de modernisation et d’équipement, de M. Jean Monnet, ne s’en préoccupait pas. Le second a bien eu un volet maritime, mais cela était lié à la construction navale. D’ailleurs, il faut bien comprendre, que ce qui a commandé davantage toute la flotte marchande, ce n’est pas le commerce maritime, mais la situation de nos chantiers de construction. Nous en avions à l’époque une quinzaine. Le plan Coureau, par exemple, a été réalisé en fonction des possibilités des chantiers. La première loi d’aide à la construction navale date de mai 1951. Pour ma part, je trouve extrêmement regrettable que toute notre politique ait été axée sur les chantiers navals. Pour e reste, aucun plan n’a tenu ses objectifs en matière de Marine marchande. Seul, le septième a réussi à atteindre, en tonnage, les objectifs, mais ce grâce au développement plus large que prévu de la flotte pétrolière. Lorsque Yves Guéna, alors Ministre des Transports, a voulu faire un plan de 20 millions de tjb, on prévoyait une couverture de 100%, si ce n’est 120% de nos besoins en flotte pétrolière. En fait de 20 millions, on n’a jamais dépassé les 11 millions 625 milles et quelques tonneaux. Une remarque qui me paraît significative : le paquebot France n’a jamais figuré dans aucun plan.
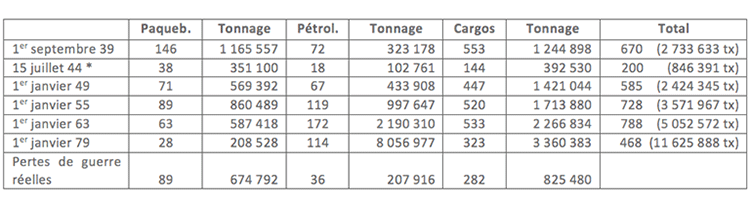
*il ne s’agit là que des statistiques des navires français, navigant à cette date dans le cadre du pool interallié.
Les politiques ne s’intéressent que fort peu au devenir du transport maritime et pourtant, il y a cette fameuse loi du 28 février 1948, que d’aucuns considèrent comme fondamentale. C’est elle qui porte organisation de la flotte de commerce. Une loi qui d’ailleurs, ne va pas dans le sens souhaité par le Conseil national de la résistance ?

Le ministre des Travaux publics et des transports de l’époque, M. Jules Moch, a défendu devant le Conseil, un projet de nationalisation, sinon totale, du moins partielle de la flotte de commerce. Ce projet de loi a été repoussé. Pour ma part, je considérais et considère toujours, que la solution étatique est très difficile à mettre en place, dans une économie de marché aussi internationalisée que celle du transport maritime. L’exemple de la CGM. Nous le montre bien. Mais revenons à la loi de 1948. Il faut bien savoir que les armateurs avaient dans le courant des années 1947, retrouvé leur liberté de manœuvre. Ils pouvaient gérer leurs navires, enfin ceux qu’ils avaient récupérer, comme bon leur semblait. La loi de 1948 a eu pour premier objectif de régler le sort des compagnies qui, avant- guerre, touchaient des subventions de l’Etat. Notamment, la Transat et ses services contractuels des Messageries maritimes, les cargos de cette compagnie n’étant pas subventionnés. On a donc d’abord cherché à définir le statut de deux grandes compagnies nationales. Le deuxième objectif de cette loi était de définir un Conseil supérieur de la marine marchande composé de représentants de l’armement, du personnel navigant, de représentants des différents ministères, plus ou moins concernés par la question, des représentants des chantiers navals et de personnes dites qualifiées. Ce conseil devait organiser le trafic, supprimer les concurrences dangereuses entre armements. Il n’a pratiquement jamais joué le rôle que le législateur entendait lui faire jouer.
On ne l’a pas tellement consulté, si ce n’est pour des broutilles. Du côté de la place de Fontenoy, on n’a jamais vu d’un bon œil cette structure de réflexion et les armateurs se sont toujours montrés réticents. Ils ont toujours considéré que le commerce maritime était leur chasse gardée et qu’ils n’avaient pas à en discuter avec les organisations syndicales. Disons que le Conseil supérieur aura, tout simplement, permis de mettre un peu d’ordre dans la maison.
1948 marque, aussi sur le plan social une grande étape, puisque la loi du 22 septembre modifie le régime des marins, instituant notamment les salaires forfaitaires répartis en 20 catégories. D’une façon générale, où en est-on sur le plan social, à la fin de la guerre ? Et que pensez-vous de cette loi ?
Contrairement à ce que certains pensent, Vichy a fait beaucoup de bien à la marine marchande, en général et à la flotte de commerce et aux navigants, en particulier. C’est sous Vichy, est-il besoin de le rappeler, que l’on a créé les écoles d’apprentissage maritimes, les premières au monde. Deuxièmement, les inscrits maritimes de l’époque ont été pratiquement tous dispensés du S.T.O. (service du travail obligatoire). Tout ceci a fait, qu’à la libération, on s’est trouvé, du moins au niveau du personnel d’exécution, avec un excédent. Il a fallu mettre sur pied une commission dite commission tripartite, pour régler les problèmes d’embarquement. Cette commission était constituée par des représentants de l’inscription maritime, des représentants des armateurs et des seules organisations syndicales existantes du moment : la Fédération des syndicats maritimes C.G.T et la Fédération C.G.T des officiers. Cette commission désignait les équipages et assurait, à ceux qui n’embarquaient pas, une solde d’attente. Jusqu’à ce que les armateurs reprennent leur entière liberté de gestion. Alors, quelle est l’importance de la loi du 22 septembre 1948 ? Elle a, à mes yeux, un grand défaut, c’est qu’elle a débouché sur un écrasement de la hiérarchie des pensions, plus forte que celle des salaires. C’est une loi qui a été promulguée dans la foulée d’une autre loi relative à la retraite des agents de la fonction publique. Les marins ont cherché la sécurité, en copiant cette loi. L’expérience leur a montré qu’ils ont fait fausse route.
La loi du 1er janvier 1930, portant sur la caisse de retraite des marins (C.R.M° est, sur le plan de la petite histoire, tout aussi, sinon plus importante. On passait d’un régime, exclusivement forfaitaire, à un régime semi-forfaitaire. En avril 1941, on a fait une loi qui établissait une distinction entre le marin salarié et le marin artisan. Cette loi a fait glisser le régime vers un système de taxations des cotisations et du calcul des pensions basé sur le salaire réel. Je considère qu’il est préférable, en effet, de s’en tenir à la rémunération réelle. Mais en 1948, on a changé son fusil d’épaule. Même modifiée par la suite, notamment pour en corriger les abus, cette loi est restée boiteuse. Son plus grave défaut est de n’avoir pas donné une définition valable du « salaire forfaitaire ». Pour le reste, elle a permis, en une période d’inflation galopante, de donner des pensions suivant le cours du coût de la vie, fut-ce parfois avec un très grand retard, pendant les deux périodes 1949-1953 et 1955-1966.
Quelle importance attribuez-vous aux accords de Seattle, de juin 1946, cette convention internationale réunie sous l’égide du B.I.T, ayant redéfini les règles de l’armement des navires ?
On n’a pas tellement fait de progrès depuis la signature de ces accords. Différentes conventions ont été signées, notamment celle portant sur la stabilisation des équipages mais, par exemple, celle traitant des salaires, de la sécurité et des effectifs n’a pas encore été ratifiée par la France. Il faut dire qu’elle était très vague. Il convenait de faire plaisir à tout le monde, car déjà apparaissaient les pavillons de complaisance. Il me faut ici souligner qu’il y eut une unité de vue entre l’organisation syndicale et le nouveau C.C.A.P dans la délégation française, pour que le B.I.T arrive à cette conclusion, que nous étions peut-être en avance du point de vue social, mais que nous étions des exemples. Les accords de Seattle ont mis sur pied un semblant de statut international du marin. Très embryonnaire. Depuis 1946, il y a quand même eu quelques avancées.
Peut-on, face aux difficultés rencontrées par les armateurs, notamment après la décolonisation, faire porter le chapeau aux seuls politiques ?
L’agressivité commerciale des armements français n’a jamais été grande. C’est un grave reproche, qu’on peut effectivement lui faire. Ceci est tout autant valable pour les compagnies nationales qua pour les autres. L’un des mérites d’Antoine Veil, alors délégué général du C.C.A.F aura été de secouer le prunier. Il aura été le premier à faire ce reproche aux armateurs. Certains ont réagi. Sous Pompidou, on s’est enfin rendu compte que la France était un pays industriel. Pour assurer nos besoins énergétiques, on a alors considérablement augmenté notre capacité de transport pétrolier. Pour nous approvisionner en minerais, on a créé une flotte de pondéreux, en favorisant les regroupements d’intérêts.
A-t-on eu raison de voir grand en matière de navires ?
Ces images de super pétroliers flambant neufs, s’en allant vers un chantier de démolition, ne sont-elles pas les conséquences d’un mauvais choix ?
C’est une erreur, parce qu’on en voit aujourd’hui les conséquences, mais le gigantisme répondait aux nécessités du moment de notre industrie. On ne peut pas dire, non plus qu’il s’agisse d’une erreur technique. Il y a une formule du père Thiers, que je fais volontiers mienne : qui dit marine, dit suite, temps et volonté. C’est absolument vrai : on ne fabrique pas une marine, pas plus qu’un marin, d’un jour à l’autre.
Aujourd’hui l’accent est mis sur le porte-conteneurs.
Les armements français ont-ils cette fois bien négocié le virage ? »

On a assurément pris du retard. Il y a peut-être une explication. Vers le milieu des années soixante, le point faible de la flotte marchande française portait sur le nombre de cargos dits en ligne. Le plan Morin, du nom du secrétaire général de la Marine marchande de l’époque, a voulu réparer cette lacune. On a donc construit des navires classiques, modernes, puisqu’automatisés, alors que d’autres déjà construisaient des porte-conteneurs. Au début des années 1970, on en était encore à se demander s’il fallait se lancer dans ce créneau. Dans les conférences Atlantique-Nord et Extrême-Orient les compagnies nationales s’y sont trouvées contraintes. Les autres armements y sont venus après. Ce retard nous est encore préjudiciable. Aujourd’hui, la C.G.M qui a fait un gros effort, en commandant à tour de bras, ne sait plus trop quoi faire de certains navires. Notre fonds de commerce dans le cadre des conférences est des plus réduit.
Pour les armateurs français, le marin coûte cher, trop cher.
Cela nuit, disent-ils à la compétitivité.
Est-ce un sentiment récent né de la crise ou cela a-t-il toujours été ?
L’armement français, sauf bien entendu, pendant la guerre, a toujours été à la recherche de sa compétitivité. Il est incontestable que notre pavillon a retrouvé, un temps durant, sa compétitivité avec les navires de gros tonnage et automatisés. En 1967-1968, nous avions 85% de nos navires qui étaient partiellement automatisés, alors que sous pavillons étrangers, cela ne dépassait pas 25%. Mais depuis, nos concurrents ont grignoté leur retard.
Comment peut-on défendre, à la fois les marins et la compétitivité des armateurs ?

C’est, effectivement, une tâche difficile. Actuellement, nous avons un nombre de postes de travail inférieur, dans l’ensemble, à celui des postes de travail sur les navires correspondants étrangers. Même sur les navires de complaisance, il y a des effectifs plus étoffés que chez nous. Mais si on considère la situation, non plus en nombre de postes de travail mais en nombre d’emplois, nous constatons une distorsion considérable. Les organisations syndicales ont toujours voulu que le marin soit traité, au minimum, comme le meilleur des ouvriers à qualification correspondante. Malheureusement, il est une vraie loi : c’est qu’il est très difficile d’adapter tous les textes de caractère général et social aux métiers de la mer. C’est vrai pour l’armateur et le marin. Le navire français rempli ras le bord est quand même d’un coût d’exploitation plus lourd que les autres. Si nous voulons avoir une flotte de commerce qui puisse satisfaire une politique industrielle et commerciale, il faut que l’Etat trouve justifiée, la raison d’être de navires français armés par des marins français, qu’il fasse ses comptes. J’avais écrit un jour : charger français. Je partais du principe que si les chargeurs français faisaient appel au pavillon français, non seulement nous aurions une flotte plus importante, mais elle nous coûterait moins cher. Je crois que le raisonnement est toujours valable. Quant aux revendications des syndicats, elles ont un fondement légitime, mais il faut admettre que l’on ne peut aborder les problèmes de la marine comme ceux de la SNCF. Ici, je le souligne à nouveau, nous sommes dans un secteur international. Il faut tenir compte de cette donne.
Nous avons parlé de l’automatisation.
Irons-nous jusqu’au navire presse-bouton.
L’introduction de la polyvalence est-elle une bonne chose ?

Je ne pense pas que nous irons jusqu’au navire presse-bouton, quoiqu’il manque bien peu de choses pour que l’on y parvienne. Nous en avons tracé l’esquisse avec le Dolabella de la Shell et l’Aquilon des Messageries maritimes, les deux seuls navires qui ont été vraiment automatisés. On les a qualifiés de navires de la troisième génération. Mais cela a coûté très cher. Actuellement, les navires français sont de la deuxième génération, c’’est à dire qu’ils disposent d’une moins grande automatisation. En ce qui concerne la polyvalence, je pense que l’on a agi un peu trop rapidement. Je ne dis pas qu’elle n’est pas nécessaire, mais nous aurions pu nous contenter, pour la formation des officiers, dans un premier temps d’un tronc commun, pendant les deux ou trois premières années. Cela dit, nos officiers ont une formation supérieure à celle des fameux masters anglais.
Hormis la loi du 22 septembre 1948, quelles ont été les grandes dates sociales qui ont marqué ces quarante dernières années
On ne peut passer sous silence les acquis de 1936 : les premières conventions collectives, les premiers congés légaux. La semaine de 40 heures a été appliquée à la Marine marchande par un décret de 37, réformé par un décret de 38. Par ailleurs, une loi de février 1946, permettant la libre discussion des salaires entre les employeurs et leurs salariés, a été aussitôt appliquée à la marine marchande. Par la suite, on se doit de signaler la réforme des structures des soldes des officiers et des salaires des maîtres et marins, durant la période 1961-1964, par l’intégration des différentes primes dans la rémunération principale. Il faut tenir compte également de la conclusion de nombreux accords d’entreprises portant sur les soldes et salaires, congés, repos pour tenir compte des nouvelles conditions de travail sur les navires automatisés. Il faut ici reconnaître qu’à partir de 1968, le C.C.A.F a été mis un peu sur la touche. Le C.C.A.F ne sert plus qu’à réactualiser constamment ces accords d’entreprises, en fonction des augmentations du coût de la vie. Des accords d’entreprises, qui restent près les uns des autres.
Autre référence, excessivement importante : le décret du 7 octobre 1968, portant sur le sur classement des treize premières catégories, mais sans rétroactivité.
Votre sentiment sur l’avenir du régime des marins ?
On a souvent accusé le régime des marins de coûter cher. C’est maintenant qu’il va coûter cher, si on s’en tient aux dispositions prévues par MM. Le Pensec et Fabius. Le décret de 1982 donne satisfaction aux organisations syndicales du personnel d’exécution. Mais on a laissé tomber les officiers. Il écrase, à nouveau la hiérarchie. Personnellement, je critique la prise en compte de toutes les anuités à 50 ans. Les officiers vont avoir une pension d’environ 60% de leur salaire forfaitaire et le personnel d’exécution aura du 66%. A terre, on vous garantit du 70% ; ce n’est donc pas sérieux. J’ai un peu peur que l’on ne scie la branche fragile du régime des marins. Ce que je redoute, c’est la cherté progressive du régime des marins. Au début des années 1970, on aurait dû réduire le rapport des retraités actifs, mais il faut désormais, compter avec l’allongement des congés, l’augmentation des salaires forfaitaires. Et puis, la loi de 1966, sur la carrière courte, prend désormais une importance considérable. Elle va jouer davantage, du fait de l’évaporation croissante qu’elle va entraîner
Propos recueillis par Claude TARIN.
Rédacteur en Chef du Marin
Propos recueillis quelques mois avant le décès de Jean SAUVÉE
